(ou l’entourloupe du développement personnel ; et de – presque – toutes spiritualités et religions)
(beaucoup pour Aurore et Thibaut, qui sauront pourquoi)
Une illumination
En 2014, j’ai eu une illumination (c’est documenté en gros par ici). J’ai fait un tarot de A à Z. Miracle ! celui-ci fonctionnait terriblement bien lorsque je réalisais des tirages, que ce soit pour moi ou mes amis. Je me souviens de la période où j’ai dessiné une à une les cartes et écrit les textes du livret les accompagnant. Je crois toujours que c’est un des objets que j’ai le plus réussi. Qu’il dit des choses pas si bêtes, égraine certaines « perles de sagesse » qui m’ont été profitable et m’accompagnent encore aujourd’hui. Je continue de faire des tarots, en y voyant une sorte de démarche artistique et spirituelle très personnelle. Soit.
Oui mais.
Un peu avant 2014, j’avais vécu coup sur coup des événements troublants : une rupture très douloureuse (qui venait réveiller de vieilles blessures d’enfance) ; une situation financière très limite, où je me suis quasiment retrouvé à la rue ; et très vite et tout en même temps, j’ai rencontré une autre jeune fille avec qui j’ai eu une histoire passionnée. Nous avions d’interminables discussions sur les histoires, la fiction, la foi, la spiritualité. Sans compter que dans son réseau d’amis, elle jouissait d’une certaine aura, d’un charisme particulier. À deux, on avait un peu un truc du couple en vue. En somme, j’étais tombé au plus bas, et, en apparence et très vite, j’étais remonté très haut.
Je me souviens, oui, de cette sensation très particulière, à la fois quand j’ai travaillé sur ce tarot, puis quand je tirais les cartes aux gens, énonçant de sages paroles mystiques, claires et limpides, comme si j’étais traversé par une puissante et douce énergie divine et cosmique. J’étais très apaisé. Un temps, j’ai vraiment cru que j’avais particulièrement avancé sur la voie de la vie. J’étais habité d’une grande sagesse. Tout semblait parfait.
Ça n’a pas duré.
La seconde jeune femme est partie. Avec elle l’illusion de réussite et de sagesse dans laquelle je m’étais bercé. Je me suis effondré.
OK, le temps a passé, je me sens mieux, j’ai bossé sur moi, j’ai réglé quelques trucs durant mes rdv avec ma psy. J’ai un boulot correct. J’ai rencontré quelqu’un, il y a eu des épisodes, nous nous sommes mariés. Aujourd’hui, ça va pas trop mal.
Mais je sais que plus jamais je ne vivrai de tels moments d’illumination intense. Plus jamais je n’atteindrai ce pic de sagesse, de pleinitude pleine – ou de grand vide si on dit ça de façon plus bouddhiste. Je me traine mes blessures, je continuerai de me sentir paumé souvent, face à la vie et au monde.
Si je raconte cela, c’est que cette expérience a mis en lumière une chose que je crois importante à partager.
Un peu de contexte
À l’époque où j’ai fait ce tarot, je ne travaillais pas. Et disons qu’en gros, entre 2013 et 2014, j’ai eu beaucoup de temps libre. Je vivais chez la famille de mon amoureuse (après avoir perdu logement et boulot), dans un bled perdu, avec une grande et magnifique forêt juste à côté. Entre deux petits boulots en intérim, je passais mes journées là-bas, allant de l’appart où j’écrivais et dessinais à la forêt où je marchais en écoutant des podcasts. En gros, je n’avais que ça à faire : être dans la contemplation et écrire de sages paroles qui me sauveraient puis juste après l’humanité.
Je voudrais ici faire un premier point de contexte : comme je l’ai dis, ce moment d’illumination mystique suivait un moment de chute et de désespoir profond. Eckhart Tolle raconte exactement la même chose dans les pages du Pouvoir du moment présent. Et si tu as un jour écouté un témoignage de chrétien, c’est systématique : les rencontres avec « Dieu », Jésus et l’église, suivent toujours un moment tragique, une période où l’on touche vraiment le fond du fond. On ne compte plus les anciens loubards reconvertis (il semblerait d’ailleurs qu’en proportion, il y ait plus de croyants en prisons que partout ailleurs dans le monde). Étonamment, personne ne raconte jamais de parcours de conversion (à une foi ou à une autre) du type : Auparavant athée, j’étais heureux et comblé dans ma vie, et d’un coup Dieu m’est apparu. Depuis ma vie est la même qu’avant mais j’ai Dieu dans ma vie. Cette histoire n’existe pas.
Ce dont je suis assez certain, et j’en témoigne depuis ma propre expérience, c’est que lorsque nous nous retrouvons dans des situations extrêmement douloureuses et angoissantes, des moments où toute la réalité sécurisante que nous nous sommes construite vacille (qu’il s’agisse de sécurité matérielle ou affective, voire d’une image de nous-même qui sécurise notre ego), nous pouvons vivre une sorte de crise psychique d’une telle intensité, risquant de sombrer dans la folie (parce qu’alors plus rien ne semble avoir de sens), que notre cerveau nous envoie pour compenser des shoots puissants d’adrénaline (ou de n’importe quoi d’autre). On passe d’un état où le monde semble se défaire sous nos pieds, à un état de félicité démente, où soudain tout semble s’illuminer. Une extase mystique en somme.
Et ça, c’est suffisant pour croire soudain en Dieu, ou mieux : croire qu’on a atteint un palier de sagesse. Précisément ce qui m’est arrivé durant la période où j’ai fait mon tarot. On passe d’un instant où notre ego est en crise, au bord de s’effondrer sur lui-même, et nous avec, à un moment où tout fait sens, d’un seul coup, où l’ego s’apaise enfin.
Je crois que c’est suffisant pour croire ensuite, en étant d’ailleurs tout à fait sincère, détenir une recette pour la bonne vie, les clefs de la sagesse, le sésame du secret du divin.
Nous avons vu en librairie un nombre démesuré d’ouvrages de développement spirituel, certains lorgnant vers la spiritualité et l’ésotérisme. Tous, à l’instar de mon tarot, proposent une recette. Si on la suit, à la fin, la vie est enfin top et simple. Ceux qui écrivent et qui animent des ateliers et des séances de coaching en sont la preuve : ils ont appliqué la recette, et regardez comme ils resplendissent. Une amie m’avait dit une chose : « C’est fou, quand tu tires ton tarot, ton aura change ; tu passes d’un gris terne à un jaune lumineux ». Ça peux paraître très ésotérique, mais j’ai tendance à la croire. Parce que c’est comme ça que je me sentais. Ça m’arrive encore parfois, subrepticement, lorsque je médite un peu, sous un rayon de soleil d’automne, et que je salue d’un geste discret l’univers. L’instant d’après j’arrive au boulot, et c’est plus la même.
La « vraie vie »
Ce qui me fascine le plus avec toute une vague de livres et méthodes, hérités pas mal d’idées bouddhistes reformulées, de vieilles pratiques païennes, et plausiblement de christianisme dans son mood le plus soft et ésotérique, ce sont ces injonctions, parfois contradictoires : on t’enjoint à devenir toi-même, tout en te défaisant de ton ego, de te défaire du matériel (Marie Kondo), tout en t’enrichissant, de te détacher, de ne rien prendre personnellement (un des accords toltèques de Don Miguel Ruiz), de vivre « l’instant présent » (in le best seller Le Pouvoir du moment présent d’Eckhart Tolle).
Mais qui formule ces belles idées que nous devrions appliquer dans nos vies ? Et depuis où et quelle sorte d’existence ? À l’instar des religieux, la plupart des coachs, auteurs de développement personnel et maîtres spirituels se sont retirés de la vie quotidienne triviale, des tracas de la vie professionnelle, des transports en commun à l’heure de pointe, de nos contraintes horaires, parfois exténuantes. Ils ne savent pas ce que c’est que d’être assis à une caisse à passer des articles et des articles, à sourire à des clients désagréables, ni ce que c’est que de nettoyer des toilettes qui puent la pisse, de ramasser des poubelles à l’aube quand le soleil se lève à peine. Ils ne font pas les 3×8 à l’usine – et s’ils ont jamais expérimenté ça, ils en sont très loin maintenant.
La plupart d’entre eux sont désormais déconnectés de ce qu’est la vie réelle de la plupart d’entre nous. Ils consacrent alors leur existence à la mise en pratique de leur recette pour la bonne vie. Et comme un musicien professionnel qui dévoue son existence à maîtriser son instrument et à inventer avec, ils sont alors plus doués que la plupart d’entre nous, plus doués pour les mélodies mémorables ou pour la félicité. Ils n’ont que ça à faire.
Être élu
J’ai souvenir d’un camarade politique qui disait à deux jeunes amis élus, un peu intimidés, « la fonction fait l’organe ». Autrement dit : ne vous inquiétez pas, le simple fait d’être élu vous donnera une assise. Et d’après quelques témoignages, il semblerait qu’effectivement, il y ait un effet, et que, surtout, à partir du moment où l’on se retrouve « élu » (le terme est significatif, non ?), le regard d’autrui sur nous change. On passe du simple humain banal à une sorte de caste au-dessus, avec pouvoirs particuliers, et privilèges accordés d’office.
Lorsque l’on accède à un poste au sein de la hiérarchie de l’église, il en est de même. La plupart du temps, un prêtre a autorité quant à l’interprétation de « la parole ». Ce sont plutôt les paroissiens qui vont venir voir le curé pour que celui-ci les éclaire sur le sens des textes. Si certains prêtres affirmeront avec humilité que ce sont parfois leurs paroissiens qui leur enseignent ce sens, cela reste rare. Et la parole d’un évéque (le big boss d’un diocèse – c’est-à-dire, en gros plusieurs églises dans une zone géographique déterminée) fera, la plupart du temps office d’évangile, et celui qui serait tenté de la contredire sera alors vu comme un incroyant, ou, à la limite, comme quelqu’un qui n’a pas encore accédé à l’illumination, au savoir. « Tu comprendras quand tu seras grand », en somme.
Lorsque l’on se retrouve, par tout un tas de circonstances fortuites, de heureux hasards, une dose de chance, de coups de pouce et de pistons, quelques qualités personnelles (qui peuvent autant être une capacité à l’écoute attentive, qu’une grande gueule et beaucoup d’aplomb), on a vite fait d’être pris dans l’illusion nous aussi. On se croit légitime d’être dans cette position d’autorité.
Imagine si tu te retrouves à être Emmanuel Macron ou Louis XIV ? Si tu es Eckhart Tolle, Don Miguel Ruiz, Jésus, Lise Bourbeau (Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même), Isabelle Padovani (nombreuses conférences sur la communication non-violente) Tich Nhat-Hanh (moine bouddhiste multi-auteur et fondateur du village des pruniers), France Guillain (ancienne navigatrice reconvertie en diététicienne deluxe)… avec tous ces gens qui te regardent intensément, qui viennent te demander conseil, qui croient profondément que tu détiens les clefs pour rendre leurs vies meilleures… Sérieusement, penses un peu à l’effet que cela fait sur ton ego, à l’image que tu te fais de toi-même ? Je repense à ma petite expérience avec mon tarot, à ce que je ressentais à ce moment, et je multiplie cette sensation de façon exponentielle. C’est démesuré.
Entourloupe
N’importe qui vivant cela ne peut qu’être persuadé d’être dans le vrai. Imagine : désormais tu n’as plus à te soucier du matériel, de fait, tu vis hyper confortablement grâce aux revenus conséquents que t’apporte ton activité de sage mystique (ici, mettons temporairement Jésus de côté) ; tu n’es plus en quête de reconnaissance, tu l’as chaque jour, donc tu blablates sur le détachement avec détachement, ton ego est tellement comblé, que tu n’y penses même plus, et c’est donc d’une facilité sans nom de parler de se défaire de son ego ; de surcroit, tu n’as plus à te fader l’harrassante vie quotidienne de la plupart des gens.
Comment, dans une telle situation, faire autrement que de croire avoir atteindre une sorte de Nirvana ? Comment ne pas avoir une aura resplendissante qui fait croire à tous autour que l’on est l’exemple ultime de l’accomplissement de l’humanité ?
Mais ceci est une entourloupe : ces exemples d’accomplissement sont hors-sol. Ils sont déconnectés de la réalité la plus triviale, pragmatique et quotidienne. Déconnectés des contraintes et des injonctions du milieu professionnel, des loyers, des fins de mois difficiles, loins de la plupart des rapports humains qui sont des rapports de forces, toujours injustes, écrasants et fatigants. Et d’une certaine façon, tant mieux pour eux. Or, cela n’est pas juste.
Un jour, tous coachs ?
J’ai toujours pensé qu’un mode de vie qui n’était pas accessible à tous était injuste. Je m’explique : nous, occidentaux, nous vivons dans un relatif confort. Au dépends de tas d’autres habitants de la planète qui triment pour nous. Ce n’est pas juste. Des travailleurs mal payés qui enrichissent un patron et des actionnaires, ce n’est pas juste. Un rentier immobilier qui s’enorgueillis de s’être libéré de la contrainte du travail, de ne plus avoir de patron qui l’emmerde, et qui peut désormais profiter de sa totale liberté, mais ce, en percevant des loyers de gens qui, eux, travaillent pour des salaires de merde, en se fadant des patrons et des hiérarchies à la con, ça n’est toujours pas juste.
Revenons à notre maître spirituel, à notre coach : s’il peut désormais se permettre d’expérimenter la félicité, c’est que sa situation repose sur le fait qu’il a des adeptes qui, eux, vivent encore dans ce monde idiot, et sont malheureux parce qu’ils aspirent eux aussi à cette félicité. Certains de ces coachs forment d’autres coachs, maintenant l’illusion. Parce que le calcul est simple : imaginons que nous atteignons tous la félicité, qu’adviendra-t-il alors, au hasard, d’Eckhart Tolle ? Le gars se retrouvera au chômage, sans plus personne pour venir l’appeler à l’aide. Si nous devenons tous coachs et qu’il n’y a plus personne à coacher, tout le système s’écroule. (Un peu comme si nous décidions de tous devenir rentiers immobilier, et que nous quittions tous nos jobs pour louer des apparts à… plus personne en fait !)
C’est ici mon premier message : si comme moi et beaucoup d’autres, tu as un jour connu une sorte d’illumination qui t’as fait croire atteindre une sorte de félicité temporaire, si tu as suivi un gourou ou une méthode, que cela a semblé t’apporter quelque chose, voire t’as vraiment apporté quelque chose, mais qu’aujourd’hui tu patauges, tu galères, et si même parfois tu as l’impression que c’est pire qu’avant… S’il t’arrive de regarder l’une ou l’autre de ces maîtres spirituels, et de penser, diantre, je suis nul, ils y arrivent, eux, ils sont tellement parfaits, et moi si pathétique ! Rappelle-toi ceci : tout ça est une imposture.
Prenons la méthode France Guillain. Arrêtons-nous sur son Miam-ô-Fruits : une recette top, plutôt bonne, diététique pour un meilleur petit déjeuner. Pour cela, il faut des fruits frais variés, bio, des fruits secs, bio, de l’huile de colza, bio. On prépare ça le matin, et, c’est peut-être le plus important : on mache. On doit donc manger son bol de fruits en 20, voire dans l’idéal, 45 minutes. Si l’on associe cela à un peu de méditation, 20 minutes le matin, c’est idéal, et qu’en plus on applique les consigne d’Al Elrod dans son Miracle Morning, c-a-d se lever plus tôt le matin (genre une heure) pour avoir du temps pour créer ou faire n’importe quelle activité qu’on juge digne, avant d’aller bosser, il faudrait alors, pour être bien serein, se lever au moins 2h30 avant de partir travailler.
Imaginons que tu bosses au Lidl, ouverture à 8h du matin, que tu dois compter 1/h de trajet, et que tu dois arriver en avance pour être en poste à l’ouverture, il te faudrait dans l’idéal être debout à 4h du matin ? Cela bien sûr ne prend pas en considération les enfants à préparer et à amener à l’école. Et nous n’avons bien sûr pas parlé de la nuit de sommeil, donc de l’heure de coucher pour maintenir le rythme.
En fait, toutes ces méthodes et rituels sont pensés par des bourgeois, des privilégiés. Aucune d’entre elle n’a été pensée et mise en pratique avec succès par un équipier Mc Donald. Prends Eckhart Tolle, retire lui son statut de maître spirituel et d’auteur à succès, retire lui tout l’argent qu’il gagne avec les ventes de son bouquin, tous les ateliers et conférences grassement rémunérées qu’il commet, et fous-le pendant trois ans au comptoir du Mc Donald de Barbesse, et ensuite on en reparle.
Je ne veux pas savoir comment s’est senti Jésus à l’époque où il a vécu, suivi par ses disciples. Ça devait être proprement insensé. On me dira que les gars crevaient la faim. Mais ça n’est pas certain. S’ils étaient, comme il le semble, soutenus par quelques bourgeois qui les entretenaient (vu qu’il était conseillé de vendre ses biens et de remettre l’argent à la communauté), ils mangeaient peut-être mieux qu’on pourrait le croire. Et dans le cas contraire, s’ils crevaient vraiment la faim, ça devait alors les mettre dans un état physique tel, que le terrain était alors hyper propice aux extases mystiques de tous poils !
Crise dans l’église
D’ailleurs, je voudrais revenir rapidement sur les prêtres chrétiens d’aujourd’hui. Je pense que si l’on excepte les gars hauts placés dans la hiérarchie – potentiellement victimes des mêmes illusions de grandeur que notre président ou n’importe quel top gourou du développement personnel –, les petits prêtres et curés de petites paroisses doivent vivre les choses très différemment qu’à l’époque où l’église avait un pouvoir immense. Ils ne roulent pas sur l’or. Mais j’estime cependant qu’ils sont relativement à l’abris du besoin. Ils sont en partie coupés du quotidien relou qui est le notre, mais se le coltinent malgré tout un peu puisqu’ils sont au contact direct de leurs paroissiens, quasiment au quotidien.
Mais surtout : ils ont de la concurrence. Un des prêtres de la paroisse de ma compagne, pour qui j’ai une réelle amitié, prêche régulièrement au sujet des églises qui se vident. Il s’inquiète de la résurgence des mouvements spirituels paganistes (qui détournent du vrai Dieu), demande à l’assemblée s’ils ont lu la Bible, s’ils témoignent et apportent la bonne nouvelle auprès d’autrui. Rappelle qu’être chrétien ce n’est pas que venir à la messe le dimanche. En apparence, son discours a pour objectif de secouer ses paroissiens, de les encourager à s’investir dans leur paroisse et dans le monde, au nom de Jésus. En apparence, ce discours est un bon vieux prêche, un brin responsabilisant (ou moralisateur, selon le point de vue), adressé à sa communauté. Je crois qu’il dit autre chose, secrètement et en fond : auparavant, les prêtres jouissaient d’un certain rôle en société, ils faisaient figure d’autorité ; ils étaient, à bien des égards et pour tous ces maîtres spirituels, ces référents, ces figures paternalistes rassurantes, c’étaient eux que l’on venait enquérir des méthodes pour mener la bonne vie. Ce que je crois, c’est qu’en s’adressant à nous, en apparence de façon paternaliste, c’est que mon ami prêtre fait secrètement confession de son angoisse existentielle, de sa peur de se voir remplacé. L’illusion qui donnait sens à son existence s’effrite doucement.
D’autres ont désormais pris cette place.
C’est pourquoi je serai un peu moins durs avec les prêtres d’aujourd’hui, qui officient dans de petits bleds, avec de moins en moins de paroissiens. Ils ne bénéficient pas des mêmes bonus que les coachs et gourous du développement spirituel et du new age. Ils ne font pas un business avec leur pratique (en tout cas, pas comme l’église a pu le faire en un temps révolu). (On pourra, au passage, un autre jour parler des prêtres ouvriers, qui eux avaient certainement tout compris).
Les méthodes de dessin
OK, je ne veux ni cracher dans la soupe, ni jeter bébé avec l’eau du bain. Plusieurs ouvrages de ces rayons m’ont ouvert des portes, éclairés sur moi-même, aidé d’une certaine façon. Le leitmotiv de Don Miguel Ruiz, « ne rien prendre personnellement », m’a aidé de si nombreuses fois dans mon travail, face aux clients désagréables et agressifs. Mais pas toujours. La méditation aussi. Cette idée du « moment présent » aussi. C’est peut-être même elle qui me fournit la critique de la posture d’un Eckhart Tolle. L’homme Eckart Tolle est-il encore dans ce moment présent ? Alors qu’il s’est extrait de notre banal et laborieux quotidien ? La question se pose. Et je serai éternellement reconnaissant envers Scott Peck : si tu ne dois lire qu’un seul livre de développement personnel, que ce soit Le Chemin le moins fréquenté.
Pourtant, je voudrais citer un autre grand sage. Dans une liste de conseils aux jeunes gens désirant devenir auteurs de BD, Matt Groening (le créateur des Simpson) formule ceci : « Ne lisez jamais de méthode de dessin ni d’ouvrages pour apprendre à faire des BD. Parce que si les gens qui font ces livres savaient de quoi ils parlent, ils seraient occupés à faire des BD et pas ces fichues méthodes. » (Au passage, je n’ai jamais compris pourquoi les cathos faisaient confiance aux prêtres pour leur donner le moindre conseil sur leur vie de couple). OK, certains de ces bouquins peuvent bien donner quelques astuces pour aider à dessiner et raconter des histoires. Mais j’ai toujours considéré que la meilleure façon d’apprendre à dessiner, c’était de dessiner. Point.
N’en est-il pas de même pour la vie ? Est-il vraiment judicieux pour apprendre à vivre la vraie vie de faire confiance à celles et ceux qui s’en sont extraits et qui sont finalement comme les auteurs de ces méthodes de dessin ? À bien y réfléchir (et ça, c’est une chose que me disait ma maman), pour apprendre à vivre, il faut vivre. Et point.
– – – – – – – – – – – – – – – –
PS : Nous n’avons pas ici discuté des implications politiques de tout ce bazar.
Mais promis, nous nous pencherons là-dessus dans un billet à venir !








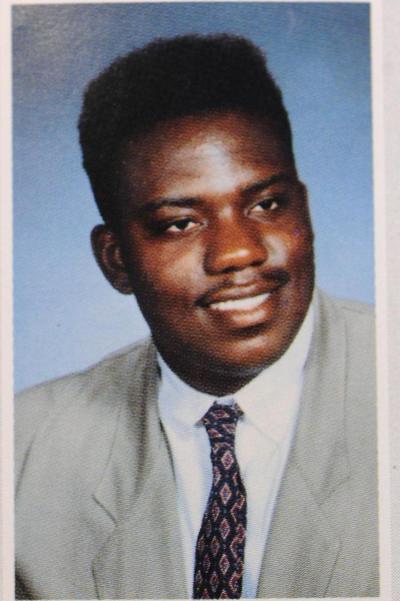
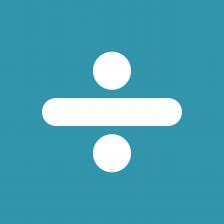
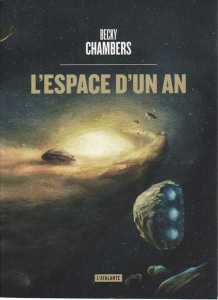 “Le
“Le  Dans Premier Contact réalisé par Denis Villeneuve, d’après la déjà très belle nouvelle de Ted Chiang (« L’histoire de ta vie », dans le recueil La Tour de Babylone), douze immenses vaisseaux extra-terrestres débarquent sur Terre. Aux USA, l’armée vient chercher Louise, une linguiste pour rejoindre la base américaine où elle va devoir travailler à décoder le langage des aliens, vite rebaptisés « heptapodes », pour savoir ce qu’ils veulent. Et c’est à peu près ça que raconte le film.
Dans Premier Contact réalisé par Denis Villeneuve, d’après la déjà très belle nouvelle de Ted Chiang (« L’histoire de ta vie », dans le recueil La Tour de Babylone), douze immenses vaisseaux extra-terrestres débarquent sur Terre. Aux USA, l’armée vient chercher Louise, une linguiste pour rejoindre la base américaine où elle va devoir travailler à décoder le langage des aliens, vite rebaptisés « heptapodes », pour savoir ce qu’ils veulent. Et c’est à peu près ça que raconte le film. Dans cet étonnant roman dont la couverture française pourrait faire croire à un space opera guerrier de plus, on suit l’équipage du Voyageur à travers l’espace. Le vaisseau est un tunnelier : leur mission, creuser des trous de vers dans l’espace, c’est-à-dire des tunnels spatiaux-temporels permettant de rejoindre un point et un autre, en très peu de temps malgré leur distance infinie.
Dans cet étonnant roman dont la couverture française pourrait faire croire à un space opera guerrier de plus, on suit l’équipage du Voyageur à travers l’espace. Le vaisseau est un tunnelier : leur mission, creuser des trous de vers dans l’espace, c’est-à-dire des tunnels spatiaux-temporels permettant de rejoindre un point et un autre, en très peu de temps malgré leur distance infinie.